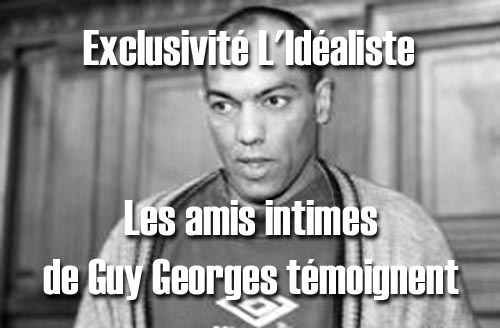 |
Edwige Ducreux et Bruno Thomé,
juin 2001
En exclusivité pour L'Idéaliste,
les amis intimes de Guy Georges ouvrent un espace de réflexion : la prévention
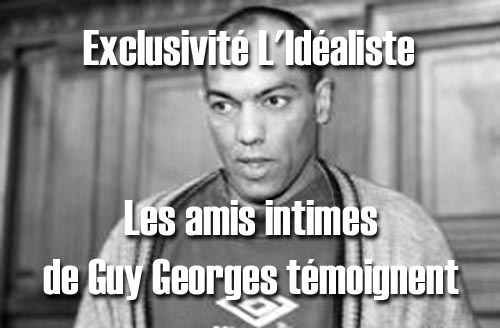 |
Edwige Ducreux et Bruno Thomé,
juin 2001
En exclusivité pour L'Idéaliste,
les amis intimes de Guy Georges ouvrent un espace de réflexion : la prévention
|
Les
troubles de la personnalité dont souffre Guy Georges sont très
déroutants car ils n'impliquent aucune altération du discernement
lors de ses passages à l'acte. Or on ne peut pas concevoir qu'un
criminel conscient de ses actes soit malade. On va alors chercher la raison
de ses crimes. Mais nos idées reçues seront une nouvelle
fois malmenées puisqu'une des caractéristiques des tueurs
en série est justement d'agir " en l'absence de tous mobiles
apparents ". Notre quête de raisons restant veine, ce qui nous
échappe deviendra alors le lieu de toutes les projections. Considéré
comme monstre, bête ou démon, on tentera de se rassurer en
invoquant la fatalité : il est né comme ça, on n'a
rien pu y faire et on ne pourra rien y faire . Hors de notre entendement,
on se refusera toute proximité avec lui, ses troubles et ses actes.
On lui déniera le statut d'être humain.
Or ce phénomène de mystification constitue une entrave à la compréhension et à la prévention de ces situations dramatiques. Les connaissances scientifiques actuelles donnent pourtant des éléments de réponses à ces interrogations. Il serait temps qu'elles soient connues du grand public et utilisées en faveur d'une réelle prévention. DIABOLISER ET REPRIMER " Ici c'est du théâtre " avait lancé Guy Georges à la cours d'Assises de Paris. Une critique que journalistes et avocats médiatiques préférèrent retourner contre son auteur : tous reprochèrent dès lors à l'accusé d'être le metteur en scène et l'acteur principal de son théâtral procès. Une vision manichéenne Mais la dramaturgie des audiences fut bien plus proche encore d'un certain cinéma hollywoodien. Car c'est comme un tueur de mauvaises série B que Guy Georges a été unanimement présenté durant son procès. Que ce soient l'avocat général, les parties civiles ou les journalistes, tous décrivirent le célèbre Tueur de l'Est parisien comme un méchant de fiction machiavélique haïssant la Terre entière, se plaisant à manipuler ses amis comme ses ennemis, et se jouant de nos bienfaisantes institutions… L'avocate générale Evelyne Gosnave-Lessieur décrivit même Guy Georges comme " l'incarnation du Mal absolu ", celui qui " a donné des leçons à l'enfer ", dans un réquisitoire final qui rappela de manière inquiétante le temps de l'Inquisition. Pourtant, lors de leur audience, la veille même
de ce plaidoyer, les experts-psychiatres avaient mis en garde contre
cette attitude qui tendait à diaboliser ce type de meurtrier.
Car une telle mystification non seulement complaît l'individu
concerné dans cette starification, mais constitue une entrave
à la compréhension et à la prévention de
ces situations dramatiques. Approximations médiatiques Mais les médias, imperméables à toute recommandation, ne se soucièrent surtout pas du " comment ". Obnubilés par l'audience, ils privilégièrent comme à leur habitude le sensationnalisme au détriment du sens. Ils eurent pourtant la prétention de faire figurer leurs articles dans la rubrique Société… Que le docteur Daniel Zagury, l'un des trois
experts-psychiatres, critique à plusieurs reprises la déformation
permanente de leurs propos par la presse, ne changea rien aux approximations
médiatiques. L'expert avait pourtant clairement averti que " si on ne confère pas cet epsilon [d'espoir] à cet homme, il ressortira encore plus dangereux. Il ne faut pas tomber dans la mythologie; si on refuse l'espoir, on contribue aux futurs massacres ". Le fichier des empreintes génétiques,
un outil mais pas une solution Si le fichier génétique constitue
un outil qu'il est important de mettre en pratique, il convient cependant
d'en rappeler les limites. C'est ce même expert, qui ne cessa de réclamer
pendant tout le procès l'extension du fichier d'empreintes génétiques
à tous les délinquants, et ce jusqu'au moindre voleur
de bicyclette… La création du fichier d'empreintes génétiques
est nécessaire mais pas suffisante. Le brandir comme unique solution
occulte tous les autres problèmes et empêche l'émergence
d'un véritable débat de fond sur la manière de
véritablement prévenir certaines formes de criminalité.
Les sciences étudiant le fonctionnement humain comme la psychiatrie, la psychologie et l'éthologie (cette branche de la biologie qui étudie les comportements animaux dont humains), et notamment leurs travaux sur les nouveau-nés, l'enfant et le développement de l'individu, pourraient aider à combattre certains maux de société à la base, et pas seulement panser les plaies… COMPRENDRE ET PREVENIR Dans son réquisitoire final, Maître Frédérique Pons, l'avocate de Guy Georges, s'était adressé directement à lui: " Vous avez été diagnostiqué psychopathe, c'est un mal insupportable car il vient aux hommes par les hommes. Vous n'êtes pas né psychopathe. Ce n'est pas votre ADN, ce n'est pas votre sang, il est le même que le nôtre. Vous n'êtes pas né psychopathe, vous êtes devenu psychopathe. " " Le gène du meurtrier n'existe pas " ont rappelé les experts psychiatres lors
du procès du Guy Georges pour dissiper toute confusion. Le fait
que Guy Georges ait été confondu par ses empreintes génétiques
n'implique pas que sa pathologie soit génétique. De la
même façon, lorsqu'un individu est identifié par
ses empreintes digitales, il n'a pas forcément commis son crime
avec ses propres mains. L'empreinte, une période d'apprentissage primordiale Ce modelage du cerveau humain débute
dans le ventre de notre mère, qui constitue le premier environnement
affectif d'un individu, et son premier foyer de communication par voies
olfactive, tactile et auditive. Des études ont en effet montré
que l'état dépressif d'une mère lors de sa grossesse
a des répercussions sur les réactions émotionnelles
de son enfant. C'est ensuite à partir des relations affectives
que le bébé partage avec son environnement parental (parents
ou substituts de parents) qu'il va tisser la matrice de ses relations
sociales et sexuelles futures. La vie prénatale et les premiers
mois d'un individu constituent donc une période d'apprentissage
particulière qu'on appelle l'empreinte. Ethologues, psychologues
et psychiatres s'accordent pour dire que le manque de repères
lors de cette période d'empreinte, engendrent des conséquences
désastreuses sur la construction d'un individu. Tous les enfants mal-traités ne deviennent
pas maltraitants, mais… Or il ne sert à rien d'uniformiser dans
une même catégorie tous les orphelins. L'âge d'abandon,
la durée passée à la DDASS, etc., sont autant de
variantes qui font que chaque parcours est unique et qu'il n'existe
pas d'entité " enfant de la DDASS " en terme de traumatisme.
Pourtant cette rencontre opportune est indispensable. Si tous les enfants maltraités ne deviennent pas des personnes ou des parents maltraitants, à l'inverse, les personnes qui souffrent de pathologies psychiques graves, entraînant des comportements déviants, ont subi des traumatismes durant l'enfance. En témoignent les chiffres avancés par l'association Famille d'Abord (ALFA) selon lesquels 75% des détenus sont passés par la DDASS. Ballotté de nourrice en nourrice, Guy Georges séjournera plusieurs mois à la DDASS avant d'intégrer, à sept mois et demi, la famille d'accueil des Morin, qui comptera jusqu'à 19 enfants. " Sorte d'élevage en batterie d'orphelins "selon les experts psychiatres, la famille Morin ne confère à ces enfants qu'une éducation impersonnelle, une " sorte de magma éducatif où n'existe aucun rapport différencié ". Les experts précisent encore qu'il s'agit d'un schéma relativement fréquent dans des familles si nombreuses, qui permet de désengorger les services de la DDASS, mais ne répond pas au besoin de l'enfant. Les rapports d'experts relatifs à l'enfance
de Guy Georges sont pour le moins évocateurs de cette situation
inadaptée. Pendant son enfance, un psychiatre avait repéré
chez lui des " problèmes psychoaffectifs ", "
nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. " Mais les comptes-rendus des éducateurs, psychologues et psychiatres ont coutume d'encombrer les tiroirs et de n'être lus… qu'à l'occasion d'un procès. Leurs recommandations pourraient pourtant servir à des changements d'orientation indispensables au bon déroulement du développement affectif, éducatif et psychique de l'enfant. Filiation et identité A l'âge de 7 ans, Guy Rampillon
est débaptisé par la DDASS. Il devient Guy Georges. Cette
mesure n'a d'autre but que d'effacer tous liens avec sa famille génétique.
C'est en effet à cette date que Mme Rampillon daigne venir attester
l'abandon de son enfant. Jusqu'ici il n'était pas adoptable car
toujours considéré sous la tutelle de sa mère.
Guy Georges, écrira en 1983 à cette administration à
laquelle il appartient désormais pour demander l'identité
de ses parents et la possibilité de reprendre son nom. Il ne
recevra jamais de réponse. " Dès qu'on touche à la filiation, on rend violent ", avertissent pourtant les psychiatres. Il serait donc temps de prendre des mesures pour parer à des situations dont on connaît les tenants et les aboutissants. Par exemple, contraindre les parents génétiques à décider de la garde ou de la relégation de leurs droits parentaux dans un laps de temps plus court pourrait favoriser l'insertion de l'enfant au sein d'une autre famille et peut-être minimiserait les troubles liés à la perte d'identité. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à
des gens qui, somme toute, ont été motivés par
un sentiment altruiste (DDASS, famille d'accueil). Mais la bonne volonté
ne suffit pas toujours.
" Vous qui représentez la société,
j'aurais aimé entendre un mot sur une société qui
fabrique si bien les psychopathes ", avait lancé Maître
Pons à l'avocate générale. Avant de se tourner
à nouveau vers Guy Georges : Rhétorique psychiatrique La psychiatrie actuelle ne reconnaît la
maladie mentale, la véritable " folie ", qu'aux seuls
psychotiques. Et selon les psychiatres, Guy Georges ne souffre d'aucune
psychose. Décrit à la fois comme " psychopathe
" et " pervers narcissique ", Guy Georges souffre donc
selon la nomenclature officielle de " troubles pathologiques sévères
de la personnalité ", pas de " maladie mentale ".
Pourtant le terme même de pathologie est indéniablement
synonyme de maladie... Des expertises orientées En droit pénal, l'irresponsabilité
est attribuée à un individu selon que la conscience et/ou
la maîtrise de ses actes a été abolie ou altérée.
Les troubles dont souffrent Guy Georges n'altèrent pas son discernement
: il fut donc reconnu comme pénalement responsable de ses actes.
Pourtant ces troubles sont générateurs de sa pathologie
meurtrière, et surtout cette possibilité de contrôler
ses actes reste discutable. Asile pour les fous, prison pour les psychopathes Depuis deux décennies, la tendance est à la responsabilisation des individus même lorsque cette décision n'est pas adaptée. Les chiffres sont éloquents : 15% des accusés étaient jugés irresponsables de leurs actes il y a vingt ans contre 0,17% à l'heure actuelle. Les conséquences sont avérées puisqu'on assiste parallèlement à une augmentation croissante du taux de suicide de ces personnes au psychisme fragile. Cette tendance à la responsabilisation aboutit à des situations absurdes même en terme de diagnostics puisque Guy Georges est jugé " pas normal " mais " pas malade ", paradoxe qui sera soulevé par l'accusé lui-même lors de l'audience des experts psychiatres. En France, le nombre de malades mentaux en prison
s'accroît donc chaque année. On estime que 20% des détenus
ont une pathologie mentale, grave dans la moitié des cas. Le
taux des psychotiques en détention est évalué à
5% de la population carcérale, soit une proportion 3 fois supérieure
à celle de la population moyenne. Et si l'on raisonne en terme
de troubles de la personnalité, ce chiffre dépasse 50%
des personnes incarcérées… En 13 ans d'incarcération, Guy Georges
n'a jamais suivi aucune psychothérapie. Reconnus systématiquement
responsables, certains criminels ne font ainsi l'objet d'une étude
que lors de l'expertise demandée par la justice. Ils échappent
ainsi à toute observation, alors qu'il y a une carence de savoir
clinique sur leurs cas. Carence qui empêche toute mise au point
de nouvelle psychothérapie adaptée. Criminels, il relève
du droit pénal. Malade il relèverait de la pathologie,
donc des soins et de la recherche. Mais la France reste scientiste, d'un scientisme fermé, réactionnaire, qui bannit de plus en plus toute recherche fondamentale. Au pays des Lumières, seules les sciences dites dures continuent d'être écoutées béatement, quand des sciences étudiant le fonctionnement humain, comme la psychologie et la psychiatrie, restent limitées à l'expertise, quand elles ne sont pas complètement négligées, comme l'éthologie. Il est pourtant plus que temps d'appliquer certains progrès de ces sciences à la prévention contre le crime, et non plus seulement à la répression.
Evidemment notre envie de compréhension
n'est pas étrangère à cette amitié. Mais
notre combat est le même que celui des familles de victimes :
empêcher qu'à l'avenir de tels meurtres aient lieu.
1 : Boris Cyrulnik,in Elle. 2 : Boris Cyrulnik, Un merveilleux malheur, 1999 et Les vilains petits canards, 2000, édition Odile Jacob. 3 : Boris Cyrulnik, in L'Express, 03 janvier 2001. 4 : Serge Bornstein, La folie en prison in Rebonds, Libération, 7-8 avril 2001. 5 : Michel Dubec et Claude Cherki-Nicklès, Crimes et sentiments, 1992, éditions du Seuil. 6 : Benoît Dauver dans l'émission
de télévision Psyché, Les écrans du savoir,
10 avril 2001, La Cinquième. |
©L'Idéaliste